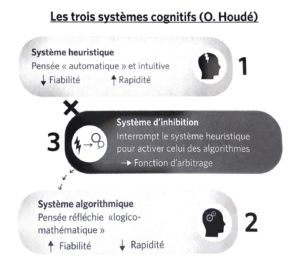Le leadership contemporain se doit d’être “authentique”. Mais, leader doit-il être fidèle à lui-même ou à des valeurs qui lui sont extérieures ? Et si par un ironique contresens cette “authenticité” invoquée n’était qu’un conformisme moral ?

Dans son dernier ouvrage intitulé “Etymologies pour survivre au chaos”, l’helléniste Andrea Marcolongo relève que ce n’est pas le manque qui menace nos paroles, mais l’approximation. La faiblesse de notre langue est due “à l’incurie de ceux qui se contentent du plus ou moins, qui nous pousse à renoncer dès le départ à l’effort nécessaire pour choisir le mot capable de rendre avec exactitude notre pensée en évitant méprises et malentendus”.
“J’ai relevé deux maux qui affligent le langage contemporain : d’un côté une hypertrophie incontrôlée qui provoque une surabondance de termes et une production effrénée de néologismes, comme si les mots que nous avons déjà ne suffisaient plus à exprimer ce que nous pensons. De l’autre, une faiblesse généralisée, presque une fragilité, qui nous pousse à ne pas avoir confiance en nos mots, à penser qu’ils ne nous suffisent pas, qu’ils ne sont pas assez précis et incisifs.” Andrea Marcolongo
Authentique, un adjectif élevé au statut de totem. Loin de faire son étymologie (“étymos” en grec signifie, d’ailleurs, “vrai”, “réel”, “authentique”…), on peut s’interroger sur l’avénement de ce terme qui a envahi l’économie, le coaching, le management et le leadership. On peut surtout être étonné à quel point ce “concept” repose sur un contresens majeur.
Le leadership authentique fait partie de ces concepts flous, qui nous semblent clairs à l’énonciation, mais qui nous échappent dès que l’on tente de le saisir. Disons qu’au fil des références, le “Leader authentique” est de manière générale celui ou celle qui est “fidèle à lui/elle-même” (“true to themselves”), ce qui semble assez proche de la définition ordinaire de l’authenticité comme un rapport fidèle à “l’être à soi”. Et puis, on insiste sur le fait qu’il ou elle est “bienveillant”, “bien intentionné”, “orienté sur les valeurs”, qu’il ou elle exerce son leadership “avec le coeur”, en “transparence”, sur la base d’une vision claire, qu’il ou elle “partage les succès avec les équipes” et est “intègre”, tout en étant “lucide sur soi-même” etc. Suivant les approches ou les modèles, l’accent est plus ou moins mis sur l’une ou l’autre des dimensions. Mais toutes nous présentent un individu profondément moral, guidé par des valeurs positives.
Authenticité : fidélité ou moralité ?
Sauf, qu’un profond contresens réside au coeur de cette idée du leadership authentique. D’un côté, être authentique consiste à être “fidèle à soi”, c’est-à-dire agir et se comporter selon sa nature, son être profond. Cela présuppose donc de connaître cet “être à soi”. Un Leader authentique serait donc celui ou celle qui agit selon sa nature (qu’il ou elle connait), que celle-ci soit “bonne” ou “mauvaise” : si Christophe est par nature prétentieux et arrogant, son authenticité lui commanderait de l’être tout autant comme Leader. De l’autre, on pare le leader authentique de vertus positives en nombre. Est authentique celui ou celle qui agit selon le code de vertus que la littérature et l’industrie du leadership prescrit qu’il ou elle soit. L’authenticité commande ici au Christophe prétentieux et arrogant par nature d’agir à l’inverse de façon bienveillante et humble.
“Si “être soi” est un devoir sacré, si ne pas transiger avec ses désirs, ses convictions ou ses aspirations profondes est un impératif auquel l’individu qui aspire à devenir maître de sa vie ne peut se soustraire, rien n’empêche de supposer que ces désirs et ces convictions puissent entrer en contradiction non seulement avec les conventions sociales, mais avec les exigences de l’intégrité et de la justice.” Claude Romano
Même terme, mais deux conceptions irréconciliables. A ma droite, l’authenticité comme quête de “l’être à soi vrai ” et comme idéal d’autoréalisation qui implique, par exemple, la recherche de son “why” fut-il peu reluisant; à ma gauche l’authenticité comme l’observance et la pratique de vertus morales dans la pratique du leadership. Dans le premier cas, l’authenticité est d’être fidèle à soi, ce qui peut amener potentiellement à adopter des comportements immoraux ou inadéquats. Dans le second cas, il s’agit d’être fidèle à une norme, c’est-à-dire l’opposé de l’authenticité. En conséquence, être un leader authentique consiste soi à se comporter potentiellement comme un “salaud” (si telle est notre nature), soit à se glisser dans un moule normatif après avoir appris à devenir “authentique”…
L’authenticité, ça marche ?
Mais au fond, pourquoi se préoccuper d’étymologie et de cohérence si le leadership authentique, ça marche ?
Le problème c’est que pas grand chose n’indique que cela marche. D’abord, les comportements les plus récompensés dans les organisations sont souvent ceux qui sont à l’opposé des valeurs prônées par le leadership authentique. Les Leaders révérés mondialement sont ou ont été le plus souvent des tyrans et des individus infréquentables. Ensuite, le leadership authentique s’inscrit dans la ligne du leadership transformationnel qui est potentiellement une source insondable de stupidité fonctionnelle dans les organisations. Enfin, parce que le leadership authentique se révèle à la pratique bien plus une posture que le Leader se construit qu’une réalité.
Pour autant, il ne viendrait à l’idée de personne de renoncer à plaider pour que les leaders adoptent des comportements moraux et qu’ils et elles soient “bienveillants”. Mais alors cessons de parler d’authenticité pour décrire ce conformisme, cette adhésion à un style de leadership inspirée de la psychologie positive qui, sous couvert de vous permettre de trouver votre “moi unique” de leader, vous invite à faire comme tout le monde. Désignons-le plutôt en fonction de ce qu’il prône : “leadership vertueux”, “leadership bienveillant”, “leadership moral”, “leadership positif” etc.
Quant à l’adjectif “authentique” et à l’authenticité personnelle, cette quête contemporaine pour l’identité “vraie”, chacun fera selon son désir. Pour ma part, je suis partisan du philosophe Clément Rosset qui affirmait que cette quête de soi est “inutile et inappétissante”. Mais c’est une autre histoire.
Références
Marcolongo, A. (2020). Etymologies pour survivre au chaos. Paris : Les Belles Lettres
Romano, C. (2019). Être soi-même. Une autre histoire de la philosophie. Paris : Gallimard.
Rosset, C. (1999). Loin de moi. Etude sur l’identité. Paris : les Editions de Minuit